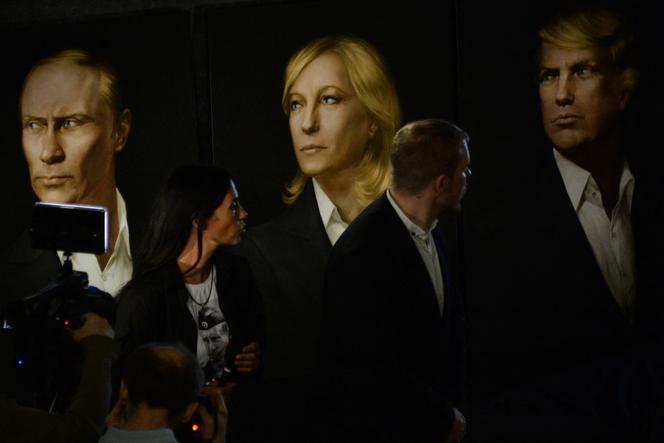Le débat actuel sur la capitalisation est un retour aux sources, car les premières lois sur les retraites n’imaginaient rien d’autre. Au moment où certains envisagent d’y revenir, examiner pourquoi et comment nous y avions renoncé n’est pas inutile. Il se pourrait en effet que les mêmes causes produisent les mêmes effets.
La loi de 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes a posé deux principes qui demeurent. D’une part, la coexistence de trois régimes – des régimes spéciaux (déjà), un régime obligatoire pour les personnes au salaire inférieur à 3 000 francs par an et un régime facultatif par capitalisation. D’autre part, la double cotisation patronale et salariale prélevée par l’employeur.
A l’époque, on était pauvre au-dessous de 1 000 francs . La cotisation (9 francs par an, autant pour l’employeur, soit 40 euros) produisait une retraite dérisoire, mais l’Etat la complétait par une allocation plus importante, de 65 à 100 francs . La capitalisation masquait une répartition sur le budget.
Les retraites ouvrières et paysannes connurent un certain succès parmi les ouvriers âgés qui, vu la mortalité d’alors, pensaient vivre assez longtemps pour bénéficier d’une retraite, une perspective improbable pour les jeunes étant donné qu’à l’époque un homme arrivé à l’âge de 40 ans pouvait espérer vivre jusqu’à 67 ans, mais un jeune de 20 ans jusqu’à 61-62 ans seulement. Or il fallait atteindre 65 ans, vite ramenés à 60, pour bénéficier de cette pension. Mais le système était une usine à gaz. Pour cotiser, les intéressés avaient le choix entre de multiples caisses, mutuelles ou autres. L’administration du système incombait à plusieurs instances.
Le recouvrement des cotisations était très compliqué : beaucoup de travailleurs étaient en effet payés à la journée, notamment à la campagne ; les manœuvres étaient embauchés pour la journée à 5 heures du matin à la porte des usines. Pour payer la fraction de centime d’une journée de cotisation à 9 francs par an, il fallait coller sur une carte l’un des 37 timbres qui existaient, et le bon !
Il vous reste 69.88% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.